(tentative de reconstitution d’une lecture des Géorgiques de Claude Simon)

Deuxième tableau | La main à plume
Pour essayer de comprendre, partons de Proust dont Claude Simon dit, dans une conférence consacrée à l’auteur de La recherche du temps perdu, qu’il n’est pas un spécialiste mais «un lecteur passionné». Il l’a lu. Beaucoup lu. A la loupe. Relu. Epluché. Décortiqué. Essoré. Attentif au détail que vous, moi, n’avons pas vu ou pour qui – vous, moi – cela même qui est vu, repéré dans le texte par Claude Simon, ne restera qu’un détail. Par exemple, ce «vaste poisson, monstre marin», «contemporain des époques primitives où la vie commençait à affluer dans l’Océan», poisson «aux innombrables vertèbres, aux nerfs bleus et roses», un poisson «comme un polychrome cathédrale de la mer». Je ne me souviens pas d’avoir lu cela dans A l’ombre des jeunes filles en fleurs. Pas plus que je n’ai vu, dans le monde qui m’entoure, de «nerfs bleus et roses». Ce qui compte pourtant, c’est que ce poisson cathédrale, détail d’une description plus vaste (comme on dirait du détail d’un vitrail sur lequel, dans l’image qu’il en donne, le photographe aurait zoomé pour attirer notre attention sur une scène en particulier se trouvant, de ce fait, détachée de l’ensemble dont elle constitue une partie), ce qui compte est que ce détail n’ait pas échappé à Claude Simon. Il en fait mention au tout début de sa conférence et profite de l’occasion pour prendre ses distances avec André Breton et Henri de Montherlant, lesquels, déplore-t-il, «proclamaient à grand bruit leur mépris de la description». Chez Breton, c’est bien connu, le rejet de l’écrivain qui refile ses cartes postales était viscéral. Et pourtant, ce «vaste poisson», «aux nerfs bleus et roses» «comme un polychrome de cathédrale», ce poisson cathédrale constituant à lui seul un poème surréaliste avant la lettre (A l’ombre des jeunes filles en fleurs est paru en 1919), aurait pu – dû ? – inspirer (même inconsciemment, comme par inadvertance, tant notre mémoire, fût-elle approximative, se mêle à notre écriture) l’auteur de Poisson soluble. Non ? Las… Tout oukase rencontre un jour sa limite.
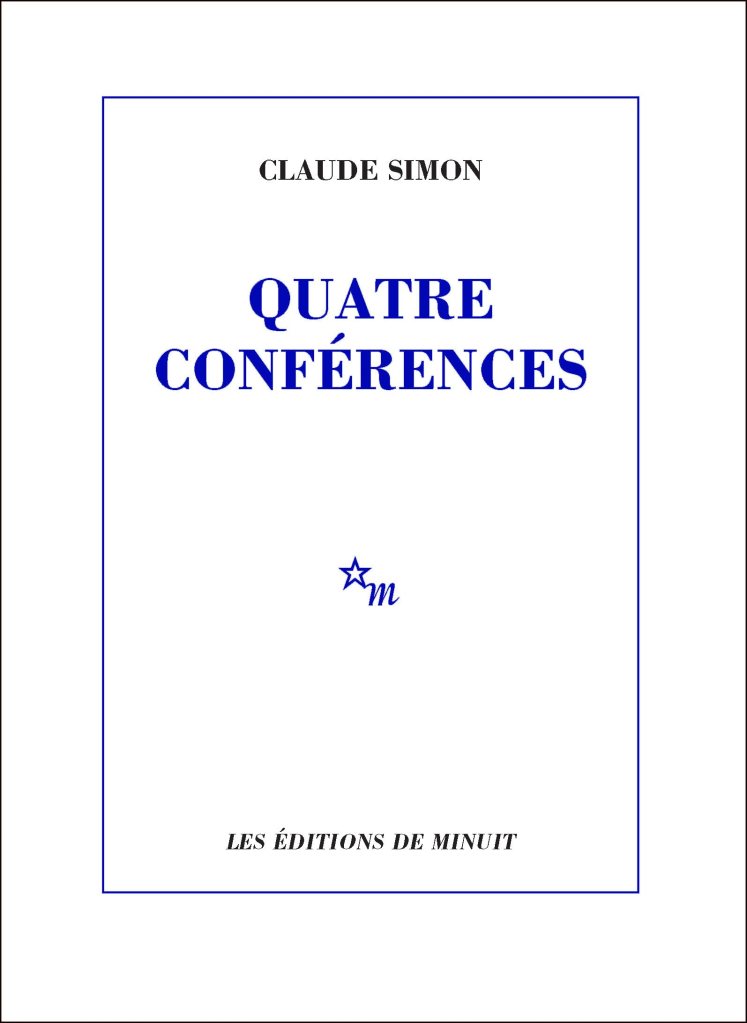
Parmi les textes de Claude Simon réunis dans ce volume, figure Le Poisson Cathédrale, une conférence consacrée à l’auteur de La recherche du temps perdu.
Dans le discours qu’il prononce devant l’Académie royale, à Stockholm, Claude Simon, contre Breton, Montherlant, place la description au centre de son œuvre. «Non plus démontrer mais montrer» : voilà en quoi écrire consiste. Ecrire comme peindre. Et c’est pourquoi, dans une description, chaque détail – chaque élément en tant qu’appartenant à une composition qui le dépasse – a son importance.
Marcel Proust qui doutait constamment de lui-même – «Suis-je écrivain ?» se demande-t-il en 1908 dans les tout premiers carnets d’esquisses de ce qui deviendra plus tard La Recherche du temps perdu – s’était fixé pour objectif de «trouver la beauté là où je ne m’étais pas figuré qu’elle fût : dans les choses les plus usuelles, dans la vie profonde des natures mortes». Pas une construction des Géorgiques qui n’obéisse à cette exigence, pas une qui échappe à cet impératif. Ainsi, quand notre regard est invité à suivre
l’infime froissement d’une feuille se détachant, tombant de branche en branche en molles glissades, se balançant dans l’air immobile comme une plume d’or terni, impondérable, éphémère, s’affalant enfin sans bruit, confondue avec les autres sur le tapis bariolé de rouges et de bistres et commençant aussitôt à pourrir
ce n’est pas une simple feuille d’arbre qui tombe et pourtant, ce n’est rien d’autre que cela. Une «chose des plus usuelles, dans la vie profonde des natures mortes».
On est encore loin, aujourd’hui, d’en avoir terminé avec la question de la description – sa place, son statut – dans le roman. Les cartes postales d’André Breton ont encore de beaux jours devant elles. Il eut toutefois des prédécesseurs. Alfred Humblot par exemple, directeur des éditions Ollendorf qui, à ce titre, eut en mains le manuscrit de Du côté de chez Swann et qui, dans la note justifiant son refus d’éditer Proust, écrivait : «Je suis peut-être bouché à l’émeri mais je ne puis comprendre qu’un monsieur puisse employer trente pages à décrire comment il se tourne et se retourne dans son lit avant de trouver le sommeil». Non, M. Humblot, vous n’êtes pas bouché à l’émeri. Votre jugement permet cependant de prendre la mesure de l’avance que le livre de Marcel Proust avait prise sur son temps. Justice est-elle pour autant rendue à l’auteur de La recherche, à son art, et à travers eux, à la description dans le roman ? Je ne mettrais pas ma main au feu. Car dans le cas contraire, Claude Simon n’aurait pas eu à affronter, à son tour, tant de détracteurs, à surmonter tant d’obstacles pour faire entendre sa voix dans le roman du XXe siècle, voix dissonante n’en démordront jamais certains critiques de son temps et leurs zélés successeurs. Voix dissonante, oui, comme en musique furent dissonants – mais ô combien innovants – les Ravel, Stravinsky, Schoenberg. Voix singulière. Unique. Ce précisément (sa nouveauté, sa liberté, son style) pour quoi nous l’aimons.
Quittons Marcel Proust, si tant est que, parlant de littérature, d’écriture, de rapport au réel, on le quitte vraiment.
Pourquoi écrivez-vous ? Qu’avez-vous à dire ? A ces questions auxquelles ont droit à peu près tous les écrivains au moins une fois dans leur vie, Paul Valéry répondait qu’écrivant, il n’avait pas «voulu dire mais voulu faire» et que «c’est cette intention de faire qui a voulu ce que j’ai dit».
il cesse de feuilleter les cahiers et REGARDE SA MAIN dans le soleil qui fait ressortir les milliers de rides plus ou moins larges se chevauchant, s’entrecroisant, mais toutes orientées dans le même sens, comme des plissements de terrain
Claude Simon fait sienne la réponse de Paul Valéry. Pour la raison qu’à ses yeux, il n’y en a pas d’autre possible. Il en veut pour preuve l’étymologie grecque du verbe faire, poiein, qui a donné poème en français. On n’écrit pas un poème. On le fait.
L’anecdote a été mille fois rapportée, déformée. Tout le monde a dans l’oreille la réplique cinglante de Stéphane Mallarmé à un invité de ses mardis, lequel, se réjouissant d’avoir recueilli dans le salon de la rue de Rome l’idée qui allait lui permettre d’écrire un poème, s’entend sermonner en des termes disant à peu près ceci : que ce n’est pas avec une idée qu’on écrit un poème mais avec des mots. Encore une fois : on n’écrit pas un poème, on le fait. On le fait avec des mots.
il REGARDE SA MAIN sur le dos de laquelle deux grosses veines gris-bleu en relief enjambent les tendons correspondant à l’annulaire et l’index. Entre l’index et le pouce écarté, la peau forme deux plis qui se croisent, comme des membranes, plus rose

Claude Simon cite Stéphane Mallarmé pour qui, «chaque fois qu’il y a effort de style, il y a versification». C’est-à-dire contrainte. Voyons. La contrainte, au lieu de brider, d’empêcher, aide à la création, y contribue. Sous la contrainte des rimes et du nombre de pieds à partir desquels ils devaient composer leurs vers composant eux-mêmes des laisses composant elles-mêmes des chants etc…, les troubadours trouvaient. Inventaient. Quoi ? La langue.
Sur le même mode, Claude Simon substitue au cogito ergo sum de Descartes – qui ferait de la littérature une affaire de pensée – un «je fais (je produis) donc je suis» qui est selon lui le propre de l’écrivain. Reprenons : la tâche de l’écrivain est de faire. Sous la contrainte des mots. De la syntaxe. De la grammaire. Faire de la langue. La littérature n’est pas affaire de philosophie. La grande affaire de la littérature, ce sont les mots, et à partir des mots, la phrase, et à partir de la phrase, le texte tout entier. Le texte. Seul.
l’ombre bosselée DE LA MAIN qui s’étire, déformée, sur le haut de la page de droite du cahier format registre couvert de mots
Ecrire, c’est faire. Faire comme «construire un pont, des machines» ou «faire venir une récolte», écrire comme travailler la terre, sur quoi nous aurons à revenir. Bientôt. Mais en attendant la main à charrue, restons sur la main à plume. Encore. Un peu.
La main, donc. Une main qui fait, comme la main de Dieu a fait l’homme, celle que Michel-Ange a peinte au plafond de la chapelle Sixtine dans la partie de la fresque représentant la Création d’Adam, main s’approchant, à la toucher, de la main de l’homme, (détail ou élément sur lequel le photographe a zoomé pour produire l’une des cartes postales parmi les plus vendues au monde), l’homme naissant de ce frôlement, la main, organe de la transmission, la main (et non le sexe) par où la vie passe. La même main qui malaxe la glaise, la modèle, lui donne forme, corps. Ou la main qui effleure, de sorte que notre existence ne tient qu’à un fil, ou plutôt un souffle, le souffle du vent qui, venant de terre ou de mer, balaie la plaine, un vent venu d’on ne sait où. D’ailleurs. De très loin.
Claude Simon ne croyait pas à l’inspiration. Encore moins au souffle divin. Il était plutôt du côté de la main qui façonne que de l’Esprit qui insuffle. D’où vient, s’interroge-t-il, un brin colère, que soit à ce point dénigré le travail de l’écrivain «dépossédé du bénéfice de ses efforts au profit de ce que certains ont appelé l’inspiration» ? D’où vient que le travail acharné de l’écrivain sur son texte passe pour de la maladresse, de l’inhabileté, tandis que l’inspiration, assurance tout risque sur la valeur finale de l’écrit, se charge de le reléguer (l’écrivain) au rang de «simple intermédiaire», «sa personne tout simplement niée», comme s’il n’existait pas ? Agacé, Claude Simon l’est. Agacé que l’écrivain soit rangé dans «une caste d’élus au nombre desquels nul ne peut espérer être admis par son mérite ou son travail». Lui voit les choses autrement.
Dans LE MOUVEMENT QU’IL FAIT POUR SAISIR le coin supérieur des pages entre le pouce et l’index les rides et les saillies des veines s’effacent et la peau se tend sur le dos de LA MAIN qui semble alors FAIT d’un marbre lisse et rosé parcouru d’un pâle lacis bleuâtre
Pour Claude Simon, l’écriture est effort. Labeur. Labour, mais nous aurons à revenir sur cette analogie entre travail d’écriture et travail de la terre. A ses yeux, la difficulté d’écrire ne disqualifie pas l’écrivain. Au contraire. Elle le désigne. Et le justifie. Sous les traits de l’artisan. De l’ouvrier. Du tâcheron qui se donne à sa besogne avec application et assiduité.
Souvenons-nous. «Je n’ai pas voulu dire mais voulu faire», proclamait Paul Valéry, lui qui pensait si fort qu’écrire enchaîne. Voici l’écrivain, à son bureau, observant par la fenêtre le mouvement du vent dans les arbres, traçant des mots, mêlant à l’histoire au long cours sa petite histoire à lui, ce qu’il voit, une main (sa main), ce qu’il entend, ce qu’il ressent au moment où il rédige et qui, formant la couche profonde (le soubassement) de l’écrit (sur quoi, tel un cavalier en selle, il trouve son équilibre, son assiette), constitue le présent de l’écriture. Ce présent, Claude Simon insiste, est celui de l’écrivain penché sur sa feuille, absorbé (comme par un buvard), tout à sa phrase, ébauchant, raturant, biffant, taillant, ciselant, émondant, polissant. Pour le dire avec ses mots à lui : faisant, tâchant.
Arrêtons-nous un instant sur ce présent de l’écriture. Car si écrire est affaire de mots, de syntaxe, écrire est aussi affaire de temps. Dans Les Géorgiques, le temps présent domine, l’emploi surabondant du participe présent rééquilibrant l’usage du passé (souvent simple) lorsque le contexte l’exige. Peu importe l’époque où se sont produits les faits rapportés. Ici, le passé se conjugue au présent. Si bien que nous, lecteurs, avançant pas à pas dans le livre, devons nous rendre à l’évidence : Claude Simon ne restitue pas un passé mais la mémoire de ce passé avec tout ce que cette mémoire comporte (nous le savons depuis Proust) de réminiscences, d’oublis, d’approximations, de trous. On se souvient, dès les premiers mots de Du côté de chez Swann, du narrateur perdu au réveil, incapable de distinguer entre ce qu’il a lu et la réalité de l’instant vécu, se prenant tout à coup pour le sujet de ce qu’il vient de lire. «Il me semblait, écrit Marcel Proust, que j’étais moi-même ce dont parlait l’ouvrage : une église, un quatuor, la rivalité de François 1er et de Charles Quint». Ces trois éléments du texte, explique Antoine Compagnon, sont constitutifs du vécu récent de l’écrivain : une visite au portail Sainte-Anne de Notre-Dame de Paris que Proust avait souhaité examiner pendant la lecture probable du traité d’architecture L’art religieux au XIIIe siècle d’Emile Mâle, l’audition lors d’un concert d’un des derniers quatuors de Beethoven et, enfin, plus ou moins éloignée dans le temps, la lecture soit de l’ouvrage de l’historien François Mignet paru en 1875 sous le titre Rivalité de François 1er et de Charles Quint, soit, plus probable, celle du tome VIII de l’Histoire de France de Michelet, livres qui évoquent tous deux cette rivalité venue – inconsciemment ? – se mêler au roman.

Voici, à propos des résurgences, dans l’écriture, d’un présent appartenant à la vie intime de l’auteur, ce que dit Claude Simon : «On n’écrit (ou ne décrit) jamais quelque chose qui s’est passé avant le travail d’écrire, mais bien ce qui se produit (…) au cours de ce travail, au présent de celui-ci». Au chapitre I des Géorgiques, la description de la main dont l’appartenance constitue une énigme (est-ce la main du cavalier sacrifié de 1940, celle du narrateur, les deux finissant par se confondre au fil du récit ? Ou bien la main de LSM ? Tantôt l’une, tantôt l’autre ?) cette main, donc, et qui, même floue (floutée) est présente, active, tournant les pages des registres et des correspondances du général d’empire LSM, en donne un exemple. Claude Simon écrit ce qu’il voit. De visu ou de mémoire. Il écrit ce qui advient autour de lui pendant son travail. Et ce qui est là, sous ses yeux – une main ridée, une mouche qui se pose dessus – est ce qui fonde le temps de l’écriture, un temps où la chronologie n’a plus cours, où passé et présent sont placés sur un même plan.
Pour l’auteur des Géorgiques, seul importe le temps de la phrase, tantôt courte, incisive, imprimant au texte un tempo rapide, saccadé, presto, all’attacca, ou au contraire étirée, flexueuse, serpentine, largo, les deux structures se mêlant, s’imbriquant dans la quête du chant. «Comment se fait-il qu’il y ait un rapport nécessaire entre le mot juste et le mot musical ?», s’interrogeait Flaubert dans une lettre à George Sand. C’est donc qu’écrire, aussi, a quelque chose à voir avec la musique, la phrase de Claude Simon n’étant pas sans lien avec l’Art de la fugue chez Bach ou le fleuve monologue intérieur qui, à lui seul, compose d’un trait l’adagio assai du concerto pour piano en sol de Maurice Ravel. La musique, cette manière ininterrompue, scandée, de dire le temps et que l’on sait éternelle depuis qu’Orphée, dépecé par les Ménades, décapité, continua de chanter tandis que le fleuve Hébros emportait dans ses flots, vers la mer, la tête du héros détachée de son corps.
Il sent un LEGER FROLEMENT sur le dos de sa MAIN. Il rouvre les yeux. Les ailes transparentes de la mouche brillent au soleil comme du mica
Devant la page blanche, Claude Simon se décrit confronté à :
primo, un «trouble magma d’émotions, de souvenirs, d’images qui se trouvent en moi» et qui constitue, ce magma, à l’état brut, comme on le dit du pétrole avant qu’il soit raffiné (travaillé), la matière première de l’écriture
secundo, à «la langue, les mots que je vais chercher pour le dire, la syntaxe par laquelle ils (les émotions, les souvenirs, les images) vont être ordonnés».
Reprenons : la matière de l’écriture est un magma d’émotions, de souvenirs et d’images que la syntaxe ordonne, le travail de l’écrivain consistant à trouver les mots (ils ne tombent pas du ciel, semés à tout vent par une main inconnue) pour le dire (ce magma), lui donner forme, consistance. Vie.
Ajoutons que le texte tient sa solidité, son équilibre, son assiette, de la «pertinence des rapports entre ses éléments» – les mots – «dont l’ordonnance, la succession et l’agencement ne relève(ro)nt plus d’une causalité extérieure au fait littéraire mais d’une causalité intérieure». C’est ici l’affirmation que le texte ne vaut que par lui-même, ne puise sa force qu’en lui, qu’il n’existe que par ce qui le constitue (les mots ordonnés). Ou, dit sous la forme d’une tautologie : le texte est par ce qui le fait texte. Rien d’autre que cela.
«Ecrire, c’est travailler dans et par la langue», bâtir un réseau de correspondances, tisser des liens entre «des objets qui n’existent pas dans le monde réel (…) mais qui, au sein de la langue, se trouvent (…) en rapport avec d’autres objets». Au sein de la langue. Dans le sein maternel de la langue. Nulle par ailleurs que là.
Dans LE MOUVEMENT QUE FAIT LA MAIN pour chasser la mouche les doigts se détendent et la peau se plisse de nouveau en d’innombrables rides ondulant par-dessus les tendons et les veines saillantes
Que dire, pour conclure, de la main qui nous a accompagnés tout au long de cette exploration ? Cette main – dont nous avons tout-à-l’heure souligné l’ambiguïté – peut aussi bien être (du fait de son ambiguïté même) la main se saisissant de la plume pour (d)écrire ce que l’œil a lu, vu et la mémoire recomposé. Main qui lit. Qui lie. Qui se souvient et qui, touchant, effleurant, voit.
La main. L’œil.
Même les yeux fermés il peut percevoir sur son visage la légère agitation des feuilles de platane qui occultent et laissent passer tour à tour les rayons du soleil
L’œil qui peut (même fermé)
voir le feuillage printanier des platanes de l’avenue, vert pâle
L’œil parce qu’écrire est affaire de regard et que, si l’objet de certaines images est de dire (ou tenter de dire) ce qui échappe aux mots, les mots de Claude Simon, eux, disent ce qui échappe aux images. Ainsi des «nerfs bleus et roses» du «vaste poisson» de Marcel Proust, poisson cathédrale dans lequel Claude Simon a vu
les entrailles même du monde étalées là, encore fumantes
et dont il a fait la matière de son livre.
(à suivre)
-o-
Sources :
- Claude Simon, Discours de Stockholm (Minuit, 1986). Quatre conférences (Minuit, 2012). Toutes les citations en italiques sont extraites des Géorgiques.
- Antoine Compagnon, Proust en 1913, séminaire au Collège de France (janvier-mai 2013).
- Paul Valéry, Ego Scriptor, Poésie Gallimard.
- Marcel Proust, Du côté de chez Swann, édition sous la direction de Jean-Yves Tadié, Bibliothèque de la Pléiade, 1987.
-o-

Sous le titre Triptyque pour Claude Simon, une première version de ce texte a fait l’objet d’un livre publié à l’automne 2013. Il fait partie d’un ensemble de cinq titres rassemblés dans la collection Piscolabis des éditions Libre d’Arts créées à Perpignan par la librairie Torcatis à l’occasion du centenaire de la naissance de l’écrivain.
