(tentative de reconstitution d’une lecture des Géorgiques de Claude Simon)
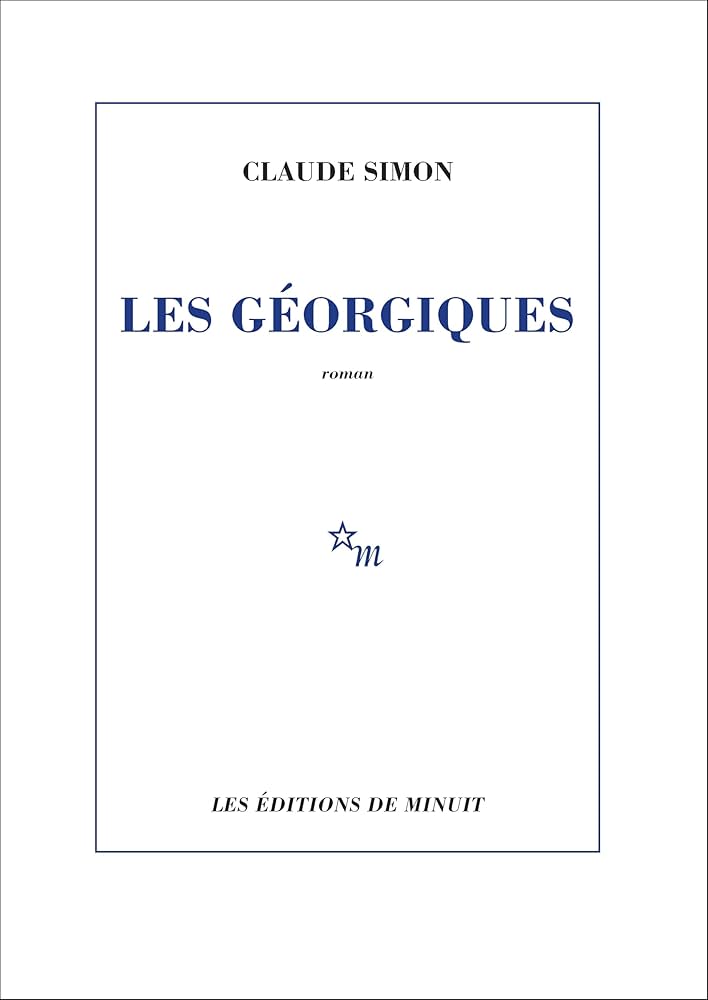
Prologue | Le chant du monde
Il n’y a pas de hasard. Les Géorgiques arrive à point nommé dans l’œuvre de Claude Simon. 1981. Quatre ans avant le prix Nobel. Forte de l’expérience accumulée dans l’élaboration minutieuse des livres passés – Le Vent, L’herbe, La route des Flandres, Le palace, Histoire, La bataille de Pharsale, Les corps conducteurs, Triptyque et Leçon de choses – l’écriture atteint son apogée (comme on dirait d’un massif montagneux son point culminant) dans ce texte polyphonique – en mouvement – qui a exigé de son auteur six ans de labeur – «pensez, je vous prie, que Les Géorgiques représente pour moi (et pour Réa qui m’a tout ce temps soutenu) six ans de travail, de doutes, d’interrogations…» – ce texte, donc, bâti selon une architecture jamais encore conçue en littérature, une audace jamais osée (mais Claude Simon ne répugnait pas au risque), à savoir l’entrecroisement de trois histoires situées dans trois périodes distinctes, celle de l’ancêtre LSM – régicide général d’Empire -, celle d’O. – engagé volontaire en Catalogne sur le front antifasciste de la guerre d’Espagne – et celle, enfin, d’un sacrifié – cavalier emporté avec son régiment dans le tourbillon de la débâcle de 1940 -, trois destinées dont l’entrelacs provoque l’implosion du temps historique et, tissant la toile d’une intemporalité singulière, libère le chant du monde.
-o-
Premier tableau | Le livre
J’ai voulu habiter ce livre, vivre avec, l’emporter partout avec moi, au travail, dans la rue, en montagne, au restaurant, l’ouvrir au hasard de ses pages, l’occuper, oui, je dis bien l’occuper (dans le sens d’y entrer, d’y trouver un logement), et l’occupant, donc, tomber sur
la plupart des occupants du wagon regard(a)nt le photographe et deux exhib(a)nt ostensiblement leurs fusils qu’ils tiennent inclinés, les longs canons pointant vers le ciel à l’extérieur des fenêtres. Ils ont tous d’épaisses chevelures etc…
cette phrase m’intimant – ce n’est déjà plus moi, lecteur, qui commande – l’ordre d’en retenir l’écho, étouffé par le crissement des pneumatiques sur l’asphalte des routes, fondant sous la pression des chaleurs de l’été, de la soustraire – la phrase – à la cacophonie du temps, la hisser au sommet d’une montagne (le Canigou, le Saint-Barthélémy, que sais-je…), pour enfin entendre sa voix dans le silence et dormir avec, à l’abri, dans la couverture, sous l’acacia, à la belle étoile, ou plus tard sous la couette, près de la cheminée, puis la remettre au monde, intacte – comme si aucun œil ne s’y était jamais posé dessus – et la livrer pure, immaculée, au concert des klaxons, à l’invective des grincheux, aux plumes rondes des thuriféraires, pour tester sa capacité de résistance, puiser en elle les raisons de ne pas tout laisser, là, en plan, à l’abandon. Démuni.
Mais. Au bout de ce décompte – plutôt mécompte – je dois l’admettre, me résigner, abdiquer – ce qu’en soi je ne vis pas du tout comme une défaite, au contraire -, c’est ce livre, Les Géorgiques, qui m’a habité, pris, transporté, jeté dans les wagons à bestiaux où tant d’hommes, de femmes, d’enfants, vieux, nourrissons, furent entassés, numérotés, séparés – les hommes d’un côté, les femmes de l’autre, les enfants, les vieillards ailleurs ou nulle part, morts ou si peu vifs, c’est tout comme – tous dé-nommés, et pour finir assassinés, c’est ce livre qui m’a poussé vers les soldats conduits au sacrifice par des états-majors imbéciles, sous les vivats inconscients de la foule, en 1914, 15, 16, 17, 18 et 1939, 40, ce livre qui m’a heurté, bousculé, piétiné, poussé hors de mon champ de vision, laissé – ni nu, ni vêtu mais dépourvu – au bord d’une route, quelque part dans les Flandres, en un lieu inconnu, plus tard dans les environs d’Ablain-Saint-Nazaire où la chair d’un mien bisaïeul fut jetée en pâture au canon, engluée dans la boue des tranchées, le cheval tenu bride courte, un œil, toujours, sur le chargement d’obus de 75 qu’en tant que conducteur il charroyait vers la ligne de feu. Ce livre – pour revenir à lui – m’a tordu dans tous les sens, exactement de la manière dont un fil de fer barbelé s’enchevêtre dans l’étau de ses chevaux de frise – pulvérisé, rendu à l’âme qui, en moi, se trouvait dans l’attente de naître, sans que – pour être tout-à-fait honnête – je n’en susse rien. Comme malgré moi. A rebours. Et dire que je le voulais mien.
Donc. Ceci aurait dû être l’histoire d’un échec. J’aurais voulu m’approprier ce livre. Le faire mien. Mais je devais me rendre à l’évidence : il n’était pas possible qu’il m’appartint. Moins parce qu’il était la propriété légitime de celui qui l’avait fait, plutôt parce qu’il constituait, là, posé devant moi, sur la table de style empire (sauvée de la dispersion) me tenant lieu de bureau, un objet en soi, hexaèdre communément désigné sous le nom de parallélépipède rectangle, disposant de sa vie propre, allant, venant, respirant, changeant de mains, transportant son odeur, passant d’un rayon de librairie à l’étagère d’une bibliothèque, de telle librairie, à Perpignan, rue Mailly, où je l’achetai sans véritable conviction, sans savoir si nous avions une chance de nous rencontrer, de nous parler, un pari en quelque sorte, cet objet, dis-je, c’est lui, au fond, qui m’a pris, emporté, contraint au silence que toute lecture impose, un repli sur soi, une surdité – momentanée, passagère, certes – mais une surdité au monde tout de même, pour mieux l’entendre ensuite et faire place à. Si bien qu’au bout du compte, le lisant, le relisant, l’ouvrant parfois au hasard – mais il n’y a pas de hasard -, me payant ce luxe désuet, comme on le dirait d’un geste désintéressé, gratuit, un tantinet aristocratique, d’en entamer la lecture au milieu d’une phrase et tombant, par exemple, sur
les ruines, les entassements sales de briques, de moellons hérissés de poutres encore fumantes à quoi pouvait soudain se réduire ce qui avait été une maison
typographiée (la phrase) en corps Garamond, caractéristique des éditions de Minuit – comme une marque de fabrique – où le livre a été publié début septembre 1981, une fois sorti des presses de l’imprimerie Corbière et Jugain à Alençon, ISBN 2707305200, et inscrit dans les registres de l’éditeur sous le numéro 1616.
Il ne vous en coûtera rien d’apprendre – si vous ne le savez déjà – que le 29 janvier 1616, à bord de l’Eendracht, les navigateurs néerlandais Willem Schouten et Jacob Le Maire aperçurent pour la première fois le Cap Horn qu’ils identifièrent comme la pointe la plus au sud de la Terre de Feu. Ecrire, c’est aborder aux rives inconnues.
Et encore, ceci, que le 19 février de cette même année 1616, Galileo Galilei fut convoqué devant ces messieurs du Saint Office, bien assis dans le pourpre de leurs certitudes, pour répondre de sa proposition selon laquelle le soleil, immobile, occuperait le centre de l’Univers autour duquel nous tournerions comme des toupies, thèse jugée «insensée et absurde», pire, «formellement hérétique», verdict sec, péremptoire, qui lui valut en première instance l’interdiction d’enseigner les théories héliocentriques de Copernic jusqu’en 1633 où, s’étant à son tour assis sur l’ignorance des doctes, il fut jeté, après la publication du Dialogue des deux systèmes du monde de Ptolémée et Copernic, dans les geôles empuanties du savoir officiel pour fait d’hérésie et, n’eût été la plus cocasse des rétractations de l’histoire des sciences, aurait terminé son équipée révolutionnaire sur le bûcher.
Lors de sa parution, Les Géorgiques suscite, comme toujours chez Claude Simon, la haine des fâcheux et l’éloge des justes. Deux camps retranchés, arc-boutés, bien campés sur leurs positions, tirant à boulets rouges sur l’adversaire sans barguigner ni trembler, trouvant sûrement du plaisir dans ce jeu donnant lieu à quelques savoureuses trouvailles langagières, de quelque point de vue que l’on se place. Personnellement, je ne me lasse pas du «catalogue cousu de fil blanc» d’Angelo Rinaldi dans L’Express, le «grand père déphasé» de François Weyergans dans Le Matin des Livres faisant toujours son petit effet dans les dîners en ville quand, pour Le Nouvel Observateur, le chapelet de Claude Roy qualifiant le livre de «biscornu, essoufflant, capiteux, insupportable, superbe, maniaque, rusé, innocent, trivial, épique…» ne manque pas d’allant. A côté de ça, il y a l’article de Jacqueline Piatier dans Le Monde pour qui «c’est un très grand livre», celui de Pierre Lepape qui salue dans Télérama son «ampleur», sa «grandeur», sans parler de l’enthousiasme de Georges Anex communiqué aux colonnes du Journal de Genève et qui voit dans Les Géorgiques le roman «le plus complet, le plus riche, le plus massif» de Claude Simon.
Un mot, encore. Pour rappeler que Claude Simon, à son heure, fut aussi léché par les flammes du bûcher. Contrairement au concert d’éloges qui parvint du monde entier, la presse française accueillit du bout des lèvres l’attribution du Prix Nobel en 1985, quand elle n’afficha pas l’air le plus dégoûté. Angelo Rinaldi, encore lui, répandit son fiel dans L’Express sous le titre «Le Nobel et la Bête», Jean Dutourd ne répugnant pas au jus de chaussettes dans France Soir. Il est plaisant de noter que ce dernier a occupé jusqu’à sa mort, en 2011, un siège à l’Académie française où le premier aura sévi vingt-quatre longues années durant, brandissant son épée et coupant des têtes, à l’occasion, ce qui devrait nous rassurer définitivement sur l’état de nos gourgandines institutions.
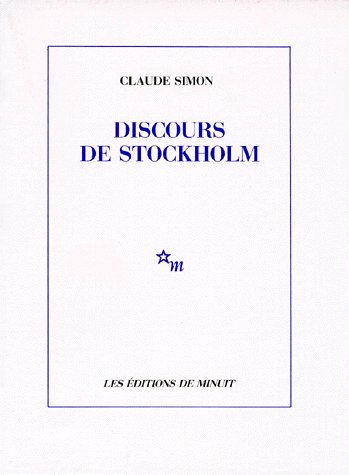
Texte du discours prononcé par Claude Simon le 10 décembre 1985 devant l’Académie royale de Suède lors de la remise officielle du Prix Nobel.
Minuit, 1986
Plaisanterie à part, car cela fait aussi partie de l’histoire de ses livres (pas seulement, en l’occurrence, de l’histoire des Géorgiques mais, concernant le Prix Nobel, de l’ensemble des livres publiés avant 1985), Claude Simon dut être suffisamment touché – blessé ? – par ce climat détestable pour l’évoquer dans son Discours de Stockholm, prononcé le 10 décembre 1985 devant l’Académie royale suédoise lors de la remise officielle du prix. Voici.
S’il se réjouit des traductions en norvégien, suédois et danois dont a bénéficié Les Géorgiques, s’il se plaît à relever que le roman, dans sa traduction finnoise cette fois, est disponible depuis peu «sur les rayons de la librairie-papeterie d’un petit hameau perdu au milieu des forêts et des lacs», il met en garde les royaux académiciens contre «les étonnements parfois scandalisés dont la grande presse s’est fait l’écho» lors de l’attribution du prix, savourant au passage qu’un «hebdomadaire français à grand tirage a(it) posé la question de savoir si le K.G.B. soviétique n’avait pas noyauté» l’Académie de Suède, ce qui dut provoquer quelques rires sous cape. Claude Simon profite en outre de la perche que ses détracteurs lui ont si aimablement tendue pour régler leur compte aux «forces conservatrices» qui sévissent «dans le domaine de la littérature et de l’art», pour leur opposer non des forces de progrès – «ce mot, dit-il, n’a, en art, aucun sens» – «mais de mouvement» et mettre «en lumière ce divorce de plus en plus prononcé (…) entre l’art vivant et le grand public peureusement entretenu dans un état d’arriération par les puissances de tout ordre dont la plus grande peur est celle du changement».
Les Géorgiques porte à son point géodésique – soit à partir duquel il est possible de prendre, à tout le moins en littérature, la mesure de toute chose – cette force de mouvement qui pousse à la naissance du texte, à sa sortie – exactement comme on dit ici à propos de la vigne que cette année, il y aura de la sortie – ou, comme un épi de blé, un arbre qui, mus par des énergies telluriques invisibles, percent la croûte terrestre et jaillissent, au milieu du monde, là même où ils sont le moins attendus. En septembre 2011, dans un article consacré à la biographie de Mireille Calle-Grüber – Claude Simon, une vie à écrire – Philippe Sollers, le même qui en 1985 avait déjà pris la défense du nobellisé contre les obscurs, employait cette formule : «Claude Simon ou la liberté inflexible». Claude Simon. Une liberté. Inflexible. Un arbre. Enraciné dans le seul lieu à ses yeux habitable : le livre.
Le livre. De liber en latin (et dans liber il y a amorce de liberté). Proprement, selon Littré, «la pellicule entre le bois et l’écorce (…), pellicule qui a donné son nom au livre, attendu qu’on a écrit anciennement dessus». La première mention du mot remonte au XIe siècle dans la Chanson de Roland où il est dit que «Marsiles fait porter un livre avant / Lo leis i fut Mahum e Tervagan…» (soit «Marsile y fait porter un livre / Où est écrite la loi de Mahomet et de Tervagan» ), ceci au premier tiers d’un poème qui compte 4 002 vers exactement. Un massif. Un monument.
Les Géorgiques, lui, a exigé de son auteur un travail colossal. «1 500 feuillets et dossiers préparatoires», a compté Mireille Calle-Grüber dans les archives de Claude Simon. C’est énorme, quand on voit que le livre imprimé, lui, ne comptera plus que 477 pages. Des milliers de feuilles donc, couvertes de notes, d’esquisses, de bouts d’essais (au cinéma on dirait des rushes), cet amas finissant par constituer un vaste champ de données à partir duquel il reste ensuite à composer, édifier, bâtir un tout cohérent selon un plan dix fois, cent fois remanié, comme qui s’attaque à la reconstitution d’un puzzle. A la différence que de modèle, là, il n’en existe pas et qu’il faut donc créer le livre de toute pièce, l’imaginer, l’inventer.
Mais comment ? Comment concevoir, c’est-à-dire se projeter vers ce qui n’existe pas encore, lorsqu’on réfute comme Claude Simon toute forme d’inspiration ? Oui, comment, quand on se revendique à ce point dépourvu de toute imagination, quand on ne reconnaît devant soi que le monde tel qu’il est, objectivement, ou pour le dire comme Baudelaire, «le monde comme si je n’étais pas là pour le dire», comment faire ?
C’est la question qui va nous occuper maintenant.
(à suivre)
-o-
Sources
- Claude Simon : Les Géorgiques (Minuit, 1981) ; Discours de Stockholm (Minuit, 1986) ; Œuvres, édition établie par Alastair B. Duncan, Bibliothèque de la Pléiade, 2006-2013.
- Mireille Calle-Grüber : Claude Simon, une vie à écrire (Seuil, 2011).
- La Chanson de Roland (laisse XLVII – vers 610 et 611), manuscrit d’Oxford, édition Raoul Mortier, Paris 1940.
-o-

Sous le titre Triptyque pour Claude Simon, une première version de ce texte a fait l’objet d’un livre publié à l’automne 2013. Il fait partie d’un ensemble de cinq titres rassemblés dans la collection Piscolabis des éditions Libre d’Arts créées à Perpignan par la librairie Torcatis à l’occasion du centenaire de la naissance de l’écrivain.
NB – Ce premier chapitre a été actualisé pour une question de date concernant l’académicien Angelo Rinaldi décédé en mai 2025.
